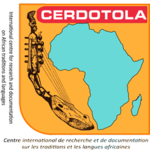Détails de la langue
Groupes locuteurs :fe'fe' = fe'efe'e (feefee, fefe, bamileke-fe'fe') = fotouni = bafang = nufi < Litt. - fe'fe' central fa' ( = Bafang < adm.) nka' ( = Banka < adm.) nee ( = Bana < adm.) njéé-poantu ( = Bandja-Babouantou) - fe'fe' nord ntii ( = Fondanti < adm.) mkwet ( = Fondjomekwet < adm.) la'fi ( = Balafi < adm.) tuni' ( = Fotouni < adm.) - ñam ( = Bangam < adm.)
Commentaires :La langue fe'fe' connaît deux variétés majeures, le fe'fe'-central et le fe'fe'-nord. Le fe'fe'-central est relativement homogène avec des variantes plus marquées vers le nord, à Bandja et Baboantou. C'est le fe'fe'-central qui sert de standard de référence : il est enseigné par " l’école nufi ", système d'éducation d'initiative communautaire tout à fait original qui fonctionne avec quelque extension depuis les années cinquante. Quant au fe'fe'-nord, il inclut les parlers les plus divergents du standard, en particulier le tugi (de Fotouni) à l'extrémité nord du Haut-Nkam, et surtout le ñam (de Bangam, dans la Mifi) qui fait en quelque sorte la transition avec le ghómala' [960]. Sur la relation avec le nda'nda', voir [905]. L'aire du fe'fe' coïncide avec le département du Haut-Nkam (Région de l’Ouest), à l'exception majeure des alentours de Kékem, au Sud-Ouest, qui font partie du pays mbo. Encore faut-il préciser que les Mbo de cette région parlent, dans leur immense majorité, le fe'fe' qui est en train de supplanter leur langue d'origine. Les locuteurs du fe’fe’ sont 123 700.
- Classification: NIGER-KORDOFAN, NIGER-CONGO, BENUE–CONGO, BANTOÏDE BANTU GRASSFIELD, EST-GRASSFIELDS, BAMILEKE–CENTRAL
- Zone linguistique: [9-0]
La zone 9 est génétiquement homogène puisqu'elle ne contient que les langues du groupe Grassfield de l'Est, et qu'elle les contient toutes.Le groupe Grassfield de l'Est - l'un des quatre groupes en lesquels se fractionne le bantou du Grassfield (avec Momo, Menchum et Ring) - est un élargissement de l'ensemble appelé naguère Mbam-Nkam, par ajout d'un certain nombre de langues parlées à la pointe nord-est de l'aire du Grassfield, donc en dehors de l'aire délimitée par le Mbam et le Nkam, d'où l'abandon de cette dénomination devenue trop étroite.C'est une zone d'extrême segmentation linguistique où le nombre de parlers distincts dépasse sans doute la centaine. Cependant, contrairement à ce qui se passe dans les monts Mandara (cf. zone 1-2), la distance linguistique entre les fragments est souvent minime et dans bien des endroits, la situation est celle d'un continuum dialectal plutôt que celle d'une juxtaposition d'entités nettement délimitées. Ceci provient sans doute du fait que le morcellement linguistique semble plus résulter d'une tendance socio-politique à marquer et à préserver l'identité des groupes dans leur langage (une langue - une chefferie) que d'un isolement géographique qui n'existe absolument pas dans cette aire.