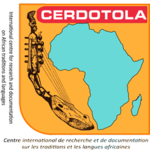Détails de la langue
Groupes locuteurs :béti – fañ ( = pahouin < aut = beti < aut, adm. = bulu-beti-fañ < aut., adm. = ekang (ekañ) < Comité de langue - ewondo ( = béti < Ewondo, aut. = yaunde < Batanga, Allemands ) foñ mvélé mbida-Mbani béné - eton – méñgisa méñgisa eton- bulu (= Boulou < adm. ) yebékóló omvañ yezum zaman - fañ fañ ( = okak < bulu, ewondo ) ntumu mvayn ( = mvae = mvay )
Commentaires :Nous sommes ici dans un continuum linguistique où il est difficile d’établir des frontières entre langues et dialectes : les différences s'accumulent de proche en proche sans pourtant que s'interrompe l'intercompréhension et il n'y a pas de discontinuité du mangisa à l’eton et à l'ewondo, de l'ewondo au bulu, ni du bulu au fañ. L’on avait distingué jusqu’alors trois pôles dans cette aire, mais des études de dialectologie plus poussées, mettent en évidence, quatre (4) groupes de plus grande affinité ou encore quatre (4) pôles: l’ewondo (ou béti), l’eton-mengisa, le bulu et le fañ. Ces quatre (4) pôles constituent l’essentiel du continuum ; puis, il y a une marge au nord de l’aire avec le bémbélé et le bébil considérés comme des langues à part.Le béti-fañ compte en tout près de 2 000 000 de locuteurs.Le pôle ewondo L'ewondo qui rassemble autour de lui tous les locuteurs qui déclarent parler béti, couvre la totalité des départements du Mfoundi, de la Mefou et Afamba, de la Mefou et Akono, du Nyong-et-So’o, Nyong-et-Mfoumou (Région du Centre) et une partie du département de l'Océan (Région du Sud). L'ewondo a été érigé en langue d'évangélisation par l'Eglise catholique. Le pôle eton-mengisaL’eton et le mengisa ont été mis ensemble à cause de leur apparentement évident dû à l’intercompréhension immédiate entre eux. Ils restent plus proches de l’ewondo avec lequel ils ont un lien assez étroit.L'eton couvre presque tout le département de la Lékié (Région du Centre), et sa variante le mengisa le nord de l’arrondissement de Saa (département de la Lékié, Région du Centre).Le pôle bulu Le bulu proprement dit, couvre tous les département de la Mvila et du Dja-et-Lobo (Région du Sud) et, avec les Yezum, le sud du département de la Haute Sanaga (Région du Centre). Avec les parlers yébékóló et omvañ, il couvre aussi le nord du dep. du Nyong-et-Mfoumou (Région du Centre) et une partie du Haut-Nyong (sud de l'arrondissement de Nguelemendouka, Région de l’Est). Le bulu constituerait une seule langue avec des variantes.Le bulu a été érigé en langue d'évangélisation par les Eglises protestantes. Le pôle fañ Le fañ dont le vrai centre se trouve au Gabon (tout le nord du Gabon) et en Guinée Equatoriale aurait des variantes dialectales telles que le ntumu, le mvayn, l’okak).Le fañ est, au Cameroun, limité à la moitié du département du Dja-et-Lobo (Région du Sud) situé au sud de Djoum et au sud-est de celui de la Mvila : au sud de Mvangan, plus des îlots dans le département de l'Océan entre Lolodorf et Kribi qui parlent l’okak. Les autres dialectes, le mvayn et le ntumu sont parlés dans le département de la Vallée du Ntem (arrondissement d'Ambam, de Ma'an et d'Olamze).
- Classification: NIGER-KORDOFAN, NIGER-CONGO, BENUE–CONGO, BANTOÏDE BANTU, BANTU EQUATORIAL, BASAA-BETI, BÉTI-FAÑ (A70)
- Zone linguistique: [4-0]
Nous abordons ici les langues bantoues en commençant par celles que M. GUTHRIE (1971) a classées en A90, A80, A70 et (en partie seulement) A40.A90 (groupe kakó), le plus oriental, est le lieu où vient se défaire le bantu dans ses structures morphologiques les plus typiques - la classification nominale ne fonctionne plus et la profusion des formes nourrit une variation individuelle et intradialectale dont il reste à mettre à jour l'organisation ou, au moins, les orientations.A70 constitue une importante aire d'intercompréhension et de variation dialectale orientée du Nord au Sud, englobant la Guinée équatoriale et tout le nord du Gabon. Côté Cameroun, l'ewondo, variété dialectale de la capitale, et sa version véhiculaire le móngó ewondo ou “ petit ewondo ” ont contribué par leur attraction et leur extension à la “pahouinisation ” des populations voisines.Entre A70 et A90, A80 (groupe méka) longtemps attiré vers le pôle béti (A70) semble touché par le phénomène de déstructuration qui a gagné tout A90. Les taux de variation intradialectaux semblent à première vue importants, et la communication inter-groupe préfère, chez les jeunes générations, le français à l'ewondo véhiculaire.Cela signifie-t-il pour A80 et A90, zones à faible peuplement et où la scolarisation progresse à grands pas, une “ déstabilisation ” des langues nationales au profit du français ? Ce qui est sûr, c'est qu'on est là dans une aire de grande incertitude linguistique.A l'inverse, la fraction de A40 que nous incluons aussi dans cette zone 4, s'ordonne autour du noyau stable et massif que constitue l'importante communauté basaa. Sur la division de A40 en un sous-groupe basaa qui vient rejoindre le sous-groupe béti-fañ et un sous-groupe tunen qui, avec A60, va constituer ce que nous appellerons le bantou du Mbam. Nous y reviendrons dans l'introduction à la zone 5.