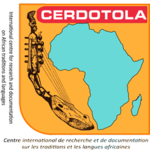Détails de la langue
Groupes locuteurs :barombi = balombe = lombe (lombi, rombi) < aut., ALCAM 1983 - barombi - kang - barombi - koto - barombi - mbo - äankon ( = abó = bankon < adm = bo < LSSA )
Commentaires :Avec 1 300 locuteurs, le lombe et le äankon sont deux dialectes d'une même langue, entre lesquels il y a parfaite intercompréhension (sur 250 mots, le taux de ressemblance dépasse 83% - avec le plus souvent identité totale des formes, ou identité à une correspondance régulière près). Lombi engendre Nkon qui engendre Bo, selon les généalogies recueillies par DIKA-AKWA. Les Barombi disent venir du pays des Abo et les Abo disent descendre des Barombi. Ce qui devient compréhensible si l'on admet que Nkon, fils de Lombi, s'est arrêté, venant du Congo, dans l'actuel pays bankon ou abo, alors que son père Lombi continuait plus au nord à fonder les établissements barombi actuels. D'où notre choix de "barombi" pour désigner la langue dans son ensemble. La fraction nord des Abo est d'arrivée plus récente et d'origine duala ; ce qui explique que les Abo soient considérés comme frères des Duala, voire confondus avec eux alors que leur langue est indubitablement plus proche de l'ensemble äasaa. Cette assimilation est renforcée du fait que tous les Abo (comme tous les Barombi) parlent aussi le duala. Le lombe proprement dit, dialecte des Barombi, est parlé dans la Région du Sud-Ouest en trois îlots distincts : deux sont situés dans le département de la Mémé. Le premier au nord du Mont-Cameroun autour du lac Barombi-Koto et le second à l'ouest de Kumba autour du lac Barombi-Mbo (tous deux dans l'arrondissement de Kumba). Le troisième, plus à l'ouest, est situé dans le département du Ndian, arrondissement d'Ekondo-Titi, au nord-est de cette ville. Les trois îlots sont enclavés dans l'aire du parler oroko [630] (oroko-est). Le äankon est parlé au nord de l'estuaire du Wouri dans toute la partie nord de l'arrondissement de Dibombari (département du Mungo, Région du Littoral) entre les aires de parler mbo, au nord et à l'ouest, et duala, au sud et à l'est.
- Classification: NIGER-KORDOFAN, NIGER-CONGO, BENUE–CONGO, BANTOÏDE BANTU, BANTU EQUATORIAL, BASAA-BETI, BASAA (A40a)
- Zone linguistique: [4-0]
Nous abordons ici les langues bantoues en commençant par celles que M. GUTHRIE (1971) a classées en A90, A80, A70 et (en partie seulement) A40.A90 (groupe kakó), le plus oriental, est le lieu où vient se défaire le bantu dans ses structures morphologiques les plus typiques - la classification nominale ne fonctionne plus et la profusion des formes nourrit une variation individuelle et intradialectale dont il reste à mettre à jour l'organisation ou, au moins, les orientations.A70 constitue une importante aire d'intercompréhension et de variation dialectale orientée du Nord au Sud, englobant la Guinée équatoriale et tout le nord du Gabon. Côté Cameroun, l'ewondo, variété dialectale de la capitale, et sa version véhiculaire le móngó ewondo ou “ petit ewondo ” ont contribué par leur attraction et leur extension à la “pahouinisation ” des populations voisines.Entre A70 et A90, A80 (groupe méka) longtemps attiré vers le pôle béti (A70) semble touché par le phénomène de déstructuration qui a gagné tout A90. Les taux de variation intradialectaux semblent à première vue importants, et la communication inter-groupe préfère, chez les jeunes générations, le français à l'ewondo véhiculaire.Cela signifie-t-il pour A80 et A90, zones à faible peuplement et où la scolarisation progresse à grands pas, une “ déstabilisation ” des langues nationales au profit du français ? Ce qui est sûr, c'est qu'on est là dans une aire de grande incertitude linguistique.A l'inverse, la fraction de A40 que nous incluons aussi dans cette zone 4, s'ordonne autour du noyau stable et massif que constitue l'importante communauté basaa. Sur la division de A40 en un sous-groupe basaa qui vient rejoindre le sous-groupe béti-fañ et un sous-groupe tunen qui, avec A60, va constituer ce que nous appellerons le bantou du Mbam. Nous y reviendrons dans l'introduction à la zone 5.