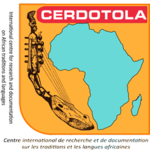Détails de la langue
Groupes locuteurs :bambili ngemba < loc. - mbili ( = bambili < adm. = mbélé < voisins, = mbgoe < mañkuñé) - mbui ( = bambui < adm. )
Commentaires :Le bambili est parlé à dix kilomètres à l'est de Bamenda, de part et d'autre de la Ring Road : le dialecte mbui au nord, et le mbili au sud (arrondissement de Tubah, département du Mezam, Région du Nord-Ouest). Le bambili est plus proche du bafut que du nkwen-mendankwe. Il est parlé par 10 000 locuteurs (ALCAM : 1984).NB : Les langues qui apparaissent sous ces codes constituent un ensemble de langues étroitement apparentées; ce que les locuteurs reconnaissent implicitement en acceptant l'appellation englobante de ngemba " je dis que ". Sur la base du critère de l'intercompréhension, on doit cependant maintenir sept langues distinctes [911] à [917] : mundum, bafut, mankon, bambili, nkwán – mendankwe, pinyin, awing.
- Classification: NIGER-KORDOFAN, NIGER-CONGO, BENUE–CONGO, BANTOÏDE BANTU GRASSFIELD, EST-GRASSFIELDS, NGEMBA
- Zone linguistique: [9-0]
La zone 9 est génétiquement homogène puisqu'elle ne contient que les langues du groupe Grassfield de l'Est, et qu'elle les contient toutes.Le groupe Grassfield de l'Est - l'un des quatre groupes en lesquels se fractionne le bantou du Grassfield (avec Momo, Menchum et Ring) - est un élargissement de l'ensemble appelé naguère Mbam-Nkam, par ajout d'un certain nombre de langues parlées à la pointe nord-est de l'aire du Grassfield, donc en dehors de l'aire délimitée par le Mbam et le Nkam, d'où l'abandon de cette dénomination devenue trop étroite.C'est une zone d'extrême segmentation linguistique où le nombre de parlers distincts dépasse sans doute la centaine. Cependant, contrairement à ce qui se passe dans les monts Mandara (cf. zone 1-2), la distance linguistique entre les fragments est souvent minime et dans bien des endroits, la situation est celle d'un continuum dialectal plutôt que celle d'une juxtaposition d'entités nettement délimitées. Ceci provient sans doute du fait que le morcellement linguistique semble plus résulter d'une tendance socio-politique à marquer et à préserver l'identité des groupes dans leur langage (une langue - une chefferie) que d'un isolement géographique qui n'existe absolument pas dans cette aire.