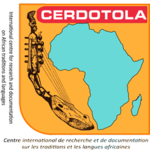Détails de la langue
Groupes locuteurs :bagyáli = gyále (giele, gieli, gyeli, bagyele, bagiele) = bajeli (bajele) = bógyáli < mabi = bógyál (bóódjyál, bóódjiál) < mvumbó = bako < äasaa = bakola < adm. = békoe < bulu, ewondo = sakuele = likoya = dabinga
Commentaires :Bagyáli et Bakola sont des Pygmées. Leurs deux parlers sont très proches l'un de l'autre et coexistent au sein des mêmes campements. En revanche, ils n'ont aucun rapport avec le baka [309] des Pygmées de l'Est. Les relations linguistiques entre bagyáli et le groupe méka sont évidentes bien que les locuteurs Mabi et Mvumbó aient quelque peine à admettre une relation de variation dialectale entre leur langue, le kwasio [421] et celle des Pygmées. Nous avons donc distingué le bagyáli du kwasio tout en leur attribuant des numéros de code qui disent leur étroit apparentement. Les Bagyáli habitent traditionnellement les forêts du département de l'Océan (Région du Sud) : autour de Kribi, Bipindi et de Lolodorf (les arrondissement de Kribi, d’Akom II, de Bipindi et de Lolodorf) et sont estimés à 4 250. Le bagyáli se rencontre aussi en Guinée Equatoriale.
- Classification: NIGER-KORDOFAN, NIGER-CONGO, BENUE–CONGO, BANTOÏDE BANTU, BANTU EQUATORIAL, BASAA-BETI, MEKA (A80)
- Zone linguistique: [4-0]
Nous abordons ici les langues bantoues en commençant par celles que M. GUTHRIE (1971) a classées en A90, A80, A70 et (en partie seulement) A40.A90 (groupe kakó), le plus oriental, est le lieu où vient se défaire le bantu dans ses structures morphologiques les plus typiques - la classification nominale ne fonctionne plus et la profusion des formes nourrit une variation individuelle et intradialectale dont il reste à mettre à jour l'organisation ou, au moins, les orientations.A70 constitue une importante aire d'intercompréhension et de variation dialectale orientée du Nord au Sud, englobant la Guinée équatoriale et tout le nord du Gabon. Côté Cameroun, l'ewondo, variété dialectale de la capitale, et sa version véhiculaire le móngó ewondo ou “ petit ewondo ” ont contribué par leur attraction et leur extension à la “pahouinisation ” des populations voisines.Entre A70 et A90, A80 (groupe méka) longtemps attiré vers le pôle béti (A70) semble touché par le phénomène de déstructuration qui a gagné tout A90. Les taux de variation intradialectaux semblent à première vue importants, et la communication inter-groupe préfère, chez les jeunes générations, le français à l'ewondo véhiculaire.Cela signifie-t-il pour A80 et A90, zones à faible peuplement et où la scolarisation progresse à grands pas, une “ déstabilisation ” des langues nationales au profit du français ? Ce qui est sûr, c'est qu'on est là dans une aire de grande incertitude linguistique.A l'inverse, la fraction de A40 que nous incluons aussi dans cette zone 4, s'ordonne autour du noyau stable et massif que constitue l'importante communauté basaa. Sur la division de A40 en un sous-groupe basaa qui vient rejoindre le sous-groupe béti-fañ et un sous-groupe tunen qui, avec A60, va constituer ce que nous appellerons le bantou du Mbam. Nous y reviendrons dans l'introduction à la zone 5.